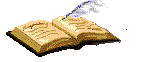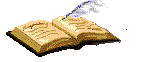Légende
du sirop d'érable
Bien avant
l’arrivée de Christophe Colomb, les tribus amérindiennes savaient comment
recueillir la sève des érables et la transformer en sirop d’érable.
Et à leur tour, les Amérindiens ont appris à nos ancêtres à fabriquer
le sirop d’érable.
Mais les Amérindiens, eux, comment ont-ils appris ?
Une
des nombreuses légendes raconte qu'un petit écureuil grimpa le long
d'un tronc d'arbre, mordit sa branche et se mit à boire.
Un
Amérindien se trouvant au pied de cet arbre le regardait et se demandait
pourquoi, puisqu'une source d'eau fraîche coulait tout près.
Il
imita l'écureuil en faisant une fente avec son couteau ... surprise,
l’eau qui s’en écoulait était sucrée !
Jusqu'alors,
sa tribu ne trouvait du sucre que dans les fruits sauvages.
Et
voilà qu’il existait un arbre qui pleure du sucre en larmes de cristal.
En
plus, il venait de découvrir un remède contre le scorbut dont les
siens souffraient souvent au printemps.
Tout
ça parce qu'il avait regardé et imité un écureuil en train de se désaltérer
avec la sève d’érable.
Une
autre légende de la tribu MicMac raconte que par une journée de printemps,
alors que le vent était encore frisquet, une vieille femme alla ramasser
la sève des érables et, comme elle goûte meilleure chaude, elle en
mit dans un pot qu'elle plaça au-dessus de son feu de teepee.
Fatiguée, elle alla s'étendre pour se reposer.
Lorsqu'elle
se réveilla, le soir était déjà là. Dans le pot, elle trouva un sirop
doré, clair et sucré.
CROYANCE
POPULAIRE
Les
premiers cris des corneilles annoncent l’arrivée du temps des sucres.
Les
premiers cris des outardes annoncent la fin de la saison.
Si
on entaille les érables lors du croissant de lune, la coulée est abondante.
Si
l’érable coule trop vite au moment de l’entaille, la coulée ne durera
pas longtemps.
L’apparition de l’oiseau des sucres signifie qu’il est temps d’entailler
(bruant des neiges).
Cet
oiseau est fréquent lorsque le temps d’entailler les érables est arrivé.
Les
papillons des sucres annoncent la fin de la coulée.
C’est
un papillon gris et blanc qui fait son apparition à la fin de la saison
des sucres et qui se noie dans les chaudières d’eau d’érable.

Jean
Cadieux, coureur des bois
Cet
héroïque coureur fait don de sa vie pour sauver sa famille et ses
amis de la nation algonquine.
Jean
Cadieux était coureur de bois.
Il
avait épousé une femme de la nation algonquine, Marie Bourdon.
Chasseur
et trappeur, il traitait avec les Indiens et échangeait des fourrures
contre des provisions et des produits manufacturés qui lui permettaient
de passer l'hiver encabané au fin fond des bois.
Un
jour de mai 1709, il descendait la rivière Outaouais avec quelques
Indiens Algonquins et sa famille pour aller vendre des fourrures.
Les
terribles rapides du Rocher Fendu ont de tout temps été un obstacle
pour la navigation.
Les
indiens et les coureurs des bois utilisaient, pour les contourner,
des sentiers de portage qui permettaient de franchir ces obstacles
naturels en transportant à dos d’homme, bateau et matériel.
Ces
endroits de portages étaient des lieux idéaux pour tendre des embuscades.
Lors
d'une halte aux portages des sept chutes à l'Île-du-Grand-Calumet,
l'un de ses compagnons parti en reconnaissance et repéra un groupe
de guerriers iroquois en embuscade dans le but de s'emparer des précieuses
fourrures.
Pour
échapper à cette embuscade, ils n’avaient d’autres choix que de franchir
les rapides déchaînés et cela, sous une nuée de flèches !
Afin
d'augmenter les chances de survie de ses compagnons et de sa famille,
Cadieux décida avec un jeune guerrier algonquin de faire diversion
et d'attirer les Iroquois loin des rapides pour permettre à sa famille
et ses amis de les franchir en toute quiétude.
Tous
se cachèrent au fond de leur canot en amont des rapides, prêts à partir
au signal convenu, soit un coup de fusil, pendant que Cadieux et son
compagnon tentaient une manœuvre de diversion. Une heure plus tard,
Cadieux et son compagnon prirent les Iroquois à revers et les attirèrent
loin des rapides.
Un
échange de coups de feu s'ensuivit : c'était le signal qu'attendait
les compagnons de Cadieux pour s'élancer dans les terribles rapides,
sous l'œil médusé de quelques Iroquois qui n'en revenaient pas et
qui étaient plus préoccupés à se protéger des assaillants que de tirer
sur les fuyards.
Avec
une dextérité hors du commun, les canotiers algonquins conduisirent
les frêles esquifs d'écorce au milieu des flots rugissants, évitant
tout contact avec les rochers qui auraient pu déchirer les écorces
de bouleaux, ce qui les auraient conduit à une mort certaine.
Deux
jours durant, ils naviguèrent à un rythme d'enfer et atteignirent
enfin le lac des Deux Montagnes où ils trouvèrent refuge.
Ne
les voyant pas revenir, trois de ses compagnons, après avoir mis famille
et fourrures en sécurité, partirent à la recherche de Cadieux et de
son compagnon.
Les
Iroquois avaient fui l'île et les Algonquins trouvèrent un petit abri
de branche vide près du portage des sept chutes.
Les
guerriers algonquins partirent à la recherche de leurs compagnons,
lisant les traces laissées par les agresseurs et assaillants comme
dans un grand livre.
Le
jeune algonquin avait été tué et, trois jours durant, les Iroquois
avaient battu l'île à la recherche de Cadieux qui continuait à guerroyer,
aussi insaisissable qu'une ombre !
Après
deux jours de recherches infructueuses, ayant perdu tout espoir de
retrouver Cadieux, ils découvrirent une croix de bois plantée en terre
près de l'abri qu'ils avaient remarqué à leur arrivée.
Et
là, à demi enterré, gisait le corps de Jean. Il tenait entre ses mains
une longue écorce de bouleau sur laquelle, avant de mourir, il avait
transcrit sous forme d'une complainte, son épopée.
Il
avait réussi à échapper aux Iroquois, mais épuisé et affaibli par
trois jours de guérilla et de privations, il avait vu revenir ses
compagnons, mais sans trouver la force de les héler.
Il
s'était préparé à la mort, creusant sa tombe et y plantant une croix
après avoir composé sa complainte.
Il
s'était ensuite enseveli avec ses dernières forces, attendant la mort
en un lieu dit le Petit Rocher de la Haute Montagne.
La
légende de Cadieux était tellement vivace que les coureurs de bois
qui passaient sur l'Outaouais s'arrêtaient sur sa tombe pour prier,
entretenir la croix et prendre un copeau pour leur porter chance.
Certains
accrochaient à un arbre proche une copie de la complainte écrite sur
une écorce de bouleau.
À
l'entrée du village de l'Île du Grand Calumet, un parc et un monument
ont été érigé en l'honneur de cet héroïque coureur de bois qui a fait
le sacrifice de sa vie pour sauver les siens.

Pilotte,
la petite chienne qui sauva Montréal
Un
jour de 1641, une petite chienne errante et ne connaissant que les
ruelles de Paris pour seules distractions, se sentait fort déprimée.
Que
faire de cette journée qui s’annonçait encore une fois monotone ?
Elle
en était là de ses réflexions, lorsqu’elle vit une drôle de charrette
qui avançait lentement dans un tapage grinçant.
La
voiture était surchargée et le pauvre cheval ne semblait avancer que
grâce aux supplications des 6 hommes qui accompagnaient le convoi.
La
première impulsion de la petite chienne fut d’aboyer, car elle était
jappeuse.
Les
hommes et le cheval l’ignorèrent.
Alors,
elle se prit au jeu et escorta le convoi durant tout le jour.
Lorsque
le convoi s’établit pour la nuit, la chienne passa la nuit à la belle
étoile avec eux. Ce fut le début d’une aventure fantastique.
Elle
continua à suivre le groupe, et une fois parvenue à Dieppe, la petite
chienne embarqua avec eux à bord d’un vaisseau qui devait traverser
l’océan pour se rendre au Canada.
Un
bon jour, ils se retrouvèrent sur les eaux du Saint-Laurent dans une
embarcation de fortune et remontant le fleuve vers l’Île-de-Montréal
pour aller fonder Montréal, appelé autrefois Ville-Marie.
Cette
petite troupe comprenait quelques femmes dont Jeanne Mance et avait
à sa tête le colonel Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur
et premier gouverneur de Ville-Marie.
Faisant fi des rigueurs de l’hiver canadien, de la forêt inhospitalière,
des difficultés d’approvisionnement et de communication, M. de Maisonneuve
et ses compagnons s’établirent sur l’Île de Montréal.
Dès
ses premiers jours sur le sol de la Nouvelle-France, la petite chienne
montra une animosité imprévue à l’endroit des iroquois.
Le
gouverneur l’ayant remarqué demanda comment on l’appelait. Comme on
ne lui connaissait pas de nom, il décida de l’appeler " Pilotte ",
du nom de ces poissons qui suivent les navires pendant des traversées
entières et guident les requins vers les proies que ceux-ci ne voient
pas.
On
l’entraîna à dépister les iroquois qui ne cessaient pas d’épier et
de harceler Ville-Marie.
Les
guerriers iroquois se cachaient un peu partout autour des fortifications
et abattaient, lorsqu’ils le pouvaient, un charpentier, un scieur
de bois ou quelque colon travaillant dans les champs mis en culture
près des fortifications.
Nuit
et jour, Ville-Marie devait soutenir une guerre acharnée et incessante
d’embuscades et de surprises.
Pilotte
faisait sa ronde chaque jour avec d’autres chiens jusque dans la forêt
et ne manquait jamais de dépister une bande d’iroquois cachés ça et
là.
Elle
était douée d’un instinct merveilleux pour les découvrir, exécutant
son travail de patrouille avec une telle persévérance et tant d’intelligence
qu’elle jetait tout le monde dans l’étonnement.
Chaque fois que les colons entendaient ses hurlements d’alerte, ils
accouraient vers M. de Maisonneuve pour l’informer de la situation.
Le
30 mars 1644, Pilotte faisait sa ronde comme tous les matins.
Soudain,
elle se met à aboyer et à hurler comme jamais auparavant et les autres
chiens qui l’accompagnaient l’imitèrent.
Tous
les colons accoururent vers M. de Maisonneuve lui disant : " Monsieur,
les ennemis sont dans le bois d’un tel côté, ne les irons-nous jamais
voir ? " Le gouverneur répondit brusquement : " Oui, vous les verrez,
qu’on se prépare tout à l’heure à marcher, mais qu’on soit aussi brave
qu’on le promet; je vais à votre tête ".
Après
avoir confié le fort à M. d’Ailleboust, M. de Maisonneuve, à la tête
de trente hommes, se dirigea vers la forêt.
Deux
cents Iroquois bien embusqués les attendaient, divisés en plusieurs
bandes.
Un
féroce combat s’engagea. M. de Maisonneuve sortit vainqueur de cette
escarmouche et devint un héros … mais il ne faut pas oublier que c’est
aussi grâce à l’alerte donnée par la brave Pilotte que Montréal fut
sauvée.
Que
serait-il advenu de Ville-Marie si Pilotte n’avait pas flairé les
200 iroquois embusqués aux alentours du fort ?
L’histoire
ne dit pas ce que devint Pilotte …
Jacques
Lacourcière,
Histoire
populaire du Québec Auteurs multiples,
Légendes du Canada français

La légende
de Madeleine de Verchères
Madeleine
de Verchères était fille de soldat.
Durant
son enfance, les soirs d’hiver, elle avait entendu raconter les actes
héroïques de Jeanne d’Arc, peut-être cela l’influença-t-elle ?
Son père,
François-Xavier Jarret épousa Marie Perrot (alors âgée de 13 ans)
à l’Île d’Orléans en 1669 et ils s’installèrent sur leurs nouvelles
terres situées entre Sorel et Montréal, à Verchères.
Ils élevèrent une nombreuse famille de 12 enfants au bord du fleuve
St-Laurent.
Madeleine
y est née le 3 mars 1678.
À cette époque troublée, les attaques iroquoises étaient fréquentes.
Mais
où commence la légende ?
C’était
le 27 octobre 1692, Madeleine avait 14 ans.
Alors
qu’elle se promenait aux abords de la Seigneurie, elle entendit tout
à coup le vieux serviteur Laviolette crier : " Sauvez-vous, Mademoiselle,
sauvez-vous, voilà les Iroquois ".
Les indiens
sortis brusquement des bois avaient capturé ou massacré une vingtaine
de gens travaillant dans les champs et se dirigeaient maintenant vers
la seigneurie familiale.
Madeleine
s’enfuit. Les Iroquois la poursuivirent.
L’un
d’entre eux la saisit par un mouchoir qu’elle portait autour du cou.
Avec
agilité, elle dénoua le mouchoir, le laissa aux mains de son ennemi
et dans une course folle rentra au fort en lui claquant la porte au
nez.
Elle
barricada la porte et entraîna sur les remparts ses deux frères âgés
de 10 et 12 ans.
" Combattons
jusqu’à la mort ", leur dit-elle; " les gentilshommes ne sont nés
que pour verser leur sang au service de Dieu et du roi ".
Pendant
huit jours, avec ses deux frères et deux vieux serviteurs complètement
terrifiés, Madeleine soutint la lutte contre 45 assaillants.
Elle
se multipliait, se montrant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, demandant
à un de ses frères et aux deux vieux serviteurs de tirer du canon
et du fusil régulièrement sur les Iroquois leur faisant croire que
le fort était bien gardé.
Au bout
de 8 jours, M. De la Monnerie vint lui porter secours, " Monsieur,
lui dit la jeune fille, soyez le bienvenu, je vous rends les armes
".
" Mademoiselle,
répondit l’officier, elles en bonnes mains ".
" Meilleures
que vous ne croyez " répondit Madeleine.
Sept
ans plus tard, en 1699, pour recevoir une pension du Roi, Madeleine
écrivit au Roi lui racontant ses exploits, ce qui allait donner naissance
à la légende.
Il était
d’usage à l’époque d’exagérer les faits pour avoir une plus grosse
pension royale. Madeleine a-t-elle exagéré ?
Nul ne
le saura jamais.
Un monument
a été érigé à Verchères à la mémoire de Madeleine.
Le 8
septembre 1706, Marie-Madeleine Jarret de Verchères épouse Pierre
Thomas Tarieu de la Naudière, Sieur de la Pérade.
Le couple
eut 5 enfants. Le 8 août 1747, Madeleine est décédée à l’âge de 69
ans à Sainte-Anne-de-la Pérade.

La légende
d'Alexis le Trotteur
Il était
plus qu’une légende car les " anciens " se souviennent encore de ses
exploits.
Il mourut
le 12 juin 1924 à l’âge de 63 ans, frappé par une locomotive qu’il
tentait de devancer.
Figure
marquante de la région de Charlevoix et du Lac-Saint-Jean au Québec,
le Musée d’histoire du Lac-Saint-Jean lui rend hommage et expose plusieurs
objets lui ayant appartenu.
Au cours
de sa vie, on lui donna toutes sortes de sobriquets : Alexis le Nigaud,
le Cheval du Nord, le Surcheval, mais c’est sous le nom d’Alexis le
Trotteur qu’il est le plus connu.
Ses prouesses
à la course ont fait le tour du pays. Il pouvait voyager aussi vite
à pied que ses contemporains à cheval ou en voiture.
Il gagnait
même des courses contre les trains.
L’anecdote
la plus connue veut qu’un jour, il se trouvait au quai de La Malbaie
avec son père qui attendait le départ du bateau pour Bagotville.
Le bateau
quittait le quai à 11h00 pour arriver à Bagotville à 23h00.
Alexis
voulait embarquer avec son père, mais celui-ci refusa de l’emmener.
Alors
Alexis lui dit : "Quand vous arriverez à Bagotville, je prendrai les
amarres du bateau"
Et il
fila.
Pour
faire le trajet par le chemin de terre, il fallait compter 146 kilomètres.
Alexis
retourna à la maison, saisit un petit fouet, se fouetta les jambes
et partit.
Lorsque
le bateau arriva à Bagotville, Alexis était sur le quai attendant
son père.
Il avait
couru la distance en moins de 12 heures.
On se
demande encore d’où lui venait cette incroyable facilité à courir.
Mais
qui était-il cet homme qui courrait plus vite que le vent ?
Alexis
Lapointe vient d’une famille de 14 enfants, il est né le 4 juin 1860
à Saint-Étienne-de-Malbaie dans la région de la Charlevoix au Québec.
Son
père exploitait une petite ferme et comme les travaux exigeaient beaucoup
de bras, Alexis faisait mille travaux pour l’aider.
Dès son
jeune âge, il développa un goût pour les chevaux et les courses.
Il se
fabriquait des petits chevaux avec des bouts de bois et s’inventait
des courses contre le vent.
Il aimait
se mesurer à d’autres gamins.
Avant
de courir, il se fouettait les jambes avec une branche et criait :
" Hue! Hue ! ".
Et il
partait comme une flèche, sautant par-dessus les obstacles et il gagnait
toujours.
En grandissant,
il devint un fameux joueurs de tours.
Il jouait
de l’harmonica avec adresse et ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était
les veillées et les fêtes pour pouvoir danser.
Il quitta
la maison familiale très jeune et exerça plusieurs métiers pour gagner
sa vie, dont celui de constructeur de fours à pain.
À cette
époque, toutes les maisons du Québec avaient un four à pain construit
à l’extérieur.
Alexis
excellait dans ce travail.
Ces fours
à pain de forme bien ronde étaient fabriqués de branches d’arbres
recourbées servant d’armature et une épaisse couche de glaise séchée
lui donnait sa forme.
Il fallait
voir Alexis piétiner la glaise dans l’auge avant d’enduire son four.
Il se
fouettait les jambes et ses muscles entraient en action.
Une vraie
machine à pilonner ! L’automne, il partait dans les chantiers (camp
de bûcheron) et revenait au printemps.
Et là,
il parcourait les veillées pour danser.
Il était
infatigable, capable de danser des gigues pendant 5 heures d’affilée.
Alexis
parsema sa vie de prouesses sans en tirer trop de gloire allant même
jusqu’à se faire prier parfois pour participer à une course.
Il n’acceptait
pas toujours les défis qu’on lui lançait, mais quand il courait, il
gagnait. On venait de loin pour le voir.
Il rendait
aussi des services contre un peu d’argent.
Par exemple,
il allait chercher le courrier dans un dépôt postal sur une distance
de 30 kilomètres et faisait ce trajet en moins d’une heure.
À qui
voulait lui lancer un défi à la course, il répondait : " Tu peux pas
courir plus vite que Poppé ! " Poppé, le cheval du nord, c’était lui.
Car voyez-vous,
Alexis était un excentrique profondément convaincu qu’il aurait dû
être un étalon et qu’il était né sous forme humaine par erreur.
Alors,
que ce soit pour construire ses fours à pain, pour aller bûcher ou
danser, jamais il ne marchait Alexis … il trottait ou courrait …
Auteur
: Jean-Claude Larouche, Alexis le trotteur

Les légendes
du pont de Québec
Que de
mystères planent autour de ce pont !
La construction
débute en juin 1901 pour se terminer avec l'inauguration officielle
le 22 août 1919.
Entre
ces 2 événements, l'effrondement d'un premier pont le 29 août 1907
où 76 ouvriers perdent la vie et une seconde catastrophe le 11 septembre
1916 avec 13 victimes lors de l'effrondement de la travée centrale.
La messe
du diable
Il n'y
a pas longtemps, le diable était fourré partout.
J'ai
entendu raconter que lorsqu'ils ont bâti le pont de Québec, ils ont
eu recours à lui.
Ils avaient
bien de la misère.
Ils avaient
fini de le faire et quand ils ont posé le dernier clou, le pont s'est
abîmé à l'eau.
Ils étaient
bien en peine.
C'est
là que le diable est arrivé.
Ils ne
l'ont pas reconnu mais ça s'est dit après que ce n'était pas d'autre
que lui.
Cet homme-là
est arrivé puis il a dit " Si vous voulez, moi je vais vous monter
comment faire et votre pont va tenir debout. "
Mais
il avait posé une condition: il fallait que l'âme de la première personne
qui passe sur le pont lui appartienne.
C'était
pas une petite condition mais ils ont accepté quand même.
Quand
ce fut le temps d'étrenner le pont, ils se demandaient bien quoi faire.
Une chance,
il y avait un curé qui était là.
Il a
dit : "Je vais chanter la messe sur un bout du pont, puis de l'autre,
vous allez envoyer un chien.
Le diable
va venir pour s'emparer de son âme et quand il va voir que c'est un
chien, il est probable qu'il va se passer quelque chose.
" Comme
de fait, le chien est parti en courant vers l'autre bout du pont,
puis quand le diable l'a vu arriver, il a voulu se sauver mais en
voyant le prêtre, il a sauté à l'eau avec le chien.
Le pont
du diable
On prétend
que le pont de Québec aurait été construit par le diable en personne,
déguisé en ingénieur.
Après
avoir retrouvé des dizaines d'ouvriers aux membres brisés, suite à
la première grande catastrophe, un drôle de personnage se serait présenté
au contremaître pour lui proposer un marché.
Le supposé
diable aurait promis un travail sans catastrophe à la condition que
l'âme de la première personne à traverser le pont lui soit remise.
Sans
trop y penser, le contremaître aurait accepté.
Comme
prévu, tout se passe bien jusqu'au jour de l'inauguration.
Repensant
à son marché, le contremaître, plutôt futé, aurait pris un énorme
chat noir et l'aurait lancé sur le pont.
Arrivé
au milieu, le chat aurait disparu subitement!
À l'endroit
même, on n'aurait trouvé qu'un petit tas de poils et de sang.
On dit
que le diable attend toujours pour se venger ...
En terminant,
avez-vous entendu parler du mystérieux boulon d'or ?
On raconte
qu'un boulon d'or aurait été fixé au pont lors de sa construction.
Plusieurs
personnes auraient tenté de le retrouver, mais jusqu'à maintenant,
il est resté introuvable ....

La légende
du Rocher Percé
Il y
a mille et une histoires entourant le magnifique Rocher Percé en Gaspésie.
Connaissez-vous
celle de la belle Blanche de Beaumont et du chevalier de Nérac ?
Au temps
où le Canada appartenait à la France, un vieux château de Normandie
abritait une jeune beauté, Blanche de Beaumont.
Or, un
beau jour de juin, Blanche, alors âgée de 16 ans, faisait la connaissance
d'un jeune et bel aristocrate, le chevalier Raymond de Nérac.
Ce fut
le coup de foudre de part et d'autre.
Bientôt,
ils se voient aussi souvent que possible devant les parents, mais
surtout dans leurs dos chaque fois qu'ils le peuvent … puis un jour,
on les fiança.
Bonheur
parfait ne peut durer, surtout dans les légendes.
Aussi
la guigne survint-elle dans la vie des jeunes amoureux, et la guigne,
cette fois, serait le Canada. Comment s'y prendre pour rendre des
amoureux parfaitement malheureux ?
Parfois
en les unissant, parfois en les séparant.
Le destin
a une expérience et une intuition terrible en cette matière, à telle
enseigne qu'il trouva immédiatement la solution la plus tragique:
envoyer le plus loin possible le jeune chevalier, et le plus loin
possible à cette époque, c'était le Canada, si vaste et si redoutable
avec ses hivers et ses iroquois.
Donc,
sur les ordres du roi, le chevalier de Nérac dut prendre un poste
en Nouvelle-France pour combattre les féroces iroquois.
Adieu
la douce vie en France, les plaisirs de la cour et la belle et adorable
fiancée de Normandie.
Une fois
en Nouvelle-France, le chevalier de Nérac pataugea dans la neige,
se perdit dans les bois, combattit les iroquois, gela dans des cabanes
mal chauffées, commanda des hommes qui n'obéissaient qu'à leur bon
gré, tira ici et là du mousquet, enfin se rongea d'ennui et d'amour
pour sa fiancée qui le hantait.
Pendant
ce temps, Blanche de Beaumont se morfondait également dans l'attente
de son bien-aimé, mais dans son château.
Vint
le jour où elle ne peut plus supporter une telle situation.
Elle
irait rejoindre son fiancé en Nouvelle-France et l'épouserait.
Une fois
cette décision prise, elle ne pensa plus qu'à ce projet audacieux,
mais n'en souffla mot à qui que ce fut, surtout pas à ses parents.
Elle
attendait, sans trop y compter, une occasion propice, qui se présenta
malheureusement.
Un bon
jour, son frère vint au château annoncer que le roi l'avait prié de
faire du service en Nouvelle-France.
Et comment
refuser au roi une prière ?
C'est
alors que Blanche s'ouvrit de son projet à ses parents et les informa
de sa ferme intention d'accompagner son frère en Nouvelle-France.
Ces derniers,
horrifiés, s'y opposèrent carrément.
Mais
que peuvent les parents contre l'amour ?
Au début
de l'automne, Blanche de Beaumont s'embarqua donc pour la Nouvelle-France
avec son frère.
Vers
la mi-octobre, leur navire croisait à la hauteur des côtes de Terre-Neuve
et tous se réjouissaient à la pensée d'arriver bientôt au terme de
ce long voyage.
Surtout
Blanche de Beaumont, naturellement, qui avait si hâte de revoir son
fiancé.
Par un
matin de temps clair, la vigie annonça un navire à bâbord qui filait
vers eux à pleines voiles.
Ce fut
d'abord une grande joie sur le galion français, mais bientôt suivie
par un sentiment d'horreur: ce qui venait vers eux avait maintenant
toutes les apparences d'un vaisseau pirate.
Lorsque
le capitaine se rendit compte qu'il s'agissait bien d'un navire pirate,
il ordonna que tout l'équipage et tous les hommes valides du navire
se regroupent.
On distribua
les armes et chacun prit le poste qu'on lui assigna dans l'attente
de l'abordage, qui fut d'ailleurs fort sanglant : coups de feu, croisements
de sabres et d'épées, cris déchirants, lamentations horribles, massacre
de boucherie.
Les Français,
bien entendu, offrirent une résistance farouche et désespérée, mais
les pirates étaient plus nombreux et mieux armés.
En bons
pirates qu'ils étaient … sic!!! … ils tuèrent tout ce qui pouvait
être tué sur le navire, sauf Blanche de Beaumont qu'ils réservaient
à leur capitaine, saccagèrent tous ce qu'ils crurent bon devoir saccager
et emportèrent avec eux tout ce qui leur tenta.
On transporta
la jeune beauté sur le navire pirate, mais non sans difficultés, car
elle se débattait comme dix et l'on avait reçu l'ordre de ne pas la
molester: la moindre égratignure coûterait une tête.
On l'enferma
dans une cabine et l'on plaça un pirate devant sa porte.
Le hublot
de sa cabine était garni de barreaux.
Pas de
fuite possible.
Elle
était complètement à la merci de cette racaille.
Le capitaine
des pirates avait donc beau jeu.
Il pouvait
faire de la jeune fille tout ce qu'il voulait, selon son caprice.
Mais
il était un bon capitaine de pirates … à certaines heures il va sans
dire.
Alors,
cette fois, au lieu de la violenter et de la violer, ce dont il était
fort tenté d'ailleurs, il décida d'user de principes et de faire les
choses en grand.
Il épouserait
Blanche de Beaumont sur le navire, devant tout son équipage.
Il en
ferait sa femme et la patronne du navire.
Les enfants
qu'elle lui donnerait auraient du sang noble.
Un ex-moine,
membre de l'équipage, officierait.
Ces respectables
intentions devaient faire perdre au capitaine sa belle proie.
Lorsque
Blanche de Beaumont sut ce qui l'attendait, elle se jura qu'elle ne
deviendrait jamais l'épouse d'un pirate.
Tous
les moyens seraient bons.
Aussi,
quand l'équipage rassemblée sur le pont vit paraître Blanche de Beaumont
s'avançant vers le capitaine et l'officiant sourire au lèvres, on
s'étonna de cette transformation si extraordinaire.
Mais
la jeune fille devait les étonner fort davantage, car juste au moment
où elle allait arriver à la hauteur du capitaine et de l'officiant,
profitant de la confiance et de la surprise qu'elle avait suscitées,
elle fit brusquement demi-tour, se mit à courir et se jeta à la mer
avant qu'on ait pu intervenir.
Ce geste
inattendu cloua l'équipage sur place.
Quand
on eut repris ses esprits, il était trop tard; Blanche de Beaumont
avait définitivement disparu dans les profondeurs de l'océan.
Le capitaine
regretta amèrement ses bonnes intentions: voilà ce que c'était que
d'avoir des principes.
On l'y
reprendrait à avoir de la conscience !
Quant
à l'équipage, il fut, dit-on, vivement impressionné.
La superstition,
commune chez ces durs, fit le reste.
Toute
la nuit, le navire glissa dans un épais brouillard, traînant à la
remorque mauvaise conscience.
Le lendemain,
lorsque le soleil eut réussi à dissiper cette brume, l'équipage se
vit devant une masse énorme: c'était le Rocher Percé.
Ce singulier
rocher, semblant flotter près du rivage comme un navire à l'ancre,
dégageait une menace mystérieuse et impitoyable.
Soudain
les pirates, figés de terreur, distinguèrent à son sommet une espèce
d'apparition voilée dans laquelle ils crurent reconnaître Blanche
de Beaumont.
Puis
brusquement, cette apparition abaissa ses mains vers le vaisseau dans
un geste de malédiction et ce dernier, avec tous ses occupants, fut
changé en un rocher dont on retrouve encore des vestiges aujourd'hui.
On dit
que le chevalier de Nérac périt peu après aux mains des iroquois.
On dit
encore qu'à certains moments, lorsque le Rocher Percé est enveloppé
de brouillard, on croit parfois entrevoir la jeune fiancée qui hante
les parages des désirs inassouvis d'un amour malheureux.

La légende
de Jos Montferrand
Le Québec
a vu naître plusieurs hommes forts tel Louis Cyr, le géant Beaupré
… mais le plus connu de tous est sûrement Jos Montferrand.
En 1959,
Gilles Vigneault en a fait le héros d'une chanson, chanson qui fut
bannie des ondes radios au moment de sortie en raison de son langage
coloré, Jos Montferrand.
Jos Montferrand
(1802-1864) est né à Montréal dans le quartier Saint-Laurent.
Il passa
à la légende grâce à sa force extraordinaire et à sa réputation de
défenseur des droits des Canadiens français.
À 16
ans, il était déjà un colosse.
Suite
à un combat sur le Champ-de-Mars entre 2 boxeurs anglais, l’un deux
fut proclamé champion du Canada.
À la
fin de ce combat, les organisateurs lancèrent un défi à la foule :
- Qui veut disputer le titre au champion du Canada ?
Qu'il
s'avance ! Jos Montferrand s’avança et chanta : - Co-co-ri-co ! faisant
ainsi savoir qu’il relevait le défi.
Jos Montferrand
ne porta qu'un seul coup de poing mais si bien appliqué qu'il battit
l'Anglais.
Le lendemain
son nom était sur toutes les lèvres.
Il passa
une bonne partie de sa vie dans la région de l’Outaouais à l’emploi
des marchands de bois comme contremaître de chantier, puis guide de
cage.
Il s’efforça
toute sa vie de faire régner l’ordre entre ces hommes qui n’étaient
pas des enfants de chœur. En ces temps " rudes ", des querelles se
déclaraient à tout moment, soit pour garder le contrôle d’un territoire
ou tout simplement parce que les anglais et les irlandais s’en étaient
pris à un français.
À cette
époque, les bûcherons coupaient des arbres, les " chaîneurs " attachaient
ensuite les arbres entiers un à l’autre formant ce que l’on appelait
des " cages ".
Ces immenses
radeaux, ou cages, étaient flottés par des hommes robustes, les "
cageux ", sur les rivières en direction des scieries ou des ports.
Les difficultés
venaient surtout des " chaîneurs ", leurs méfaits ne se comptaient
plus.
Jos Montferrand
allait d'un chantier à l'autre pour mater ces fiers-à-bras qui terrorisaient
tout le monde.
Il se
battait aux poings et en dernier recours, il se servait de son pied
dévastateur qui lui donnait invariablement la victoire sur n'importe
quel adversaire.
Un coup
de savate et l’opposant ne tenait plus debout !
Tout
le monde connaissait la force de Jos Montferrand et redoutait cette
adresse qui lui permettait d'assommer quelqu'un d'un coup de pied.
Son plus
grand exploit eut lieu sur le pont qui enjambe le gouffre de la Chaudière,
entre la ville de Hull et Ottawa, lorsqu’il dû affronter une centaine
de " chaîneurs " qui lui avaient tendus un guet-apens.
Sur les
deux rives, les curieux accoururent pour voir le combat d'un seul
homme contre cent.
Ils connaissaient
presque tous Montferrand mais ils ne donnaient pas cher de sa peau
devant tant d'adversaires.
Chaussé
de ses lourdes bottes cloutées, il affronta courageusement les " chaîneurs
" et la panique gagna bientôt le rang de ses attaquants qui ne cherchèrent
plus qu’à atteindre la rive.
Seul
contre cent, il avait déjoué ses adversaires.
La foule
l'acclama.
Cette
prouesse fit le tour du pays.
Jos Montferrand
n'avait pas encore trente ans et il était célèbre.
Il se
battit encore souvent, toujours avec le souci de prouver à la face
du monde que les gens de sa race, les Canadiens de langue française,
n'allaient pas supporter les affronts.
Bien
sûr, il avait les muscles et la force pour le dire !
Ses exploits
inspirèrent quelques-unes des histoires les plus invraisemblables.
En 1828,
dans une auberge de Montréal, Jos marqua un jour d’un vigoureux coup
de pied le plafond de sa semelle cloutée.
Cette
auberge devint célèbre car on vint de partout voir cette curiosité.
La raison
est qu’un soldat de l’armée britannique, le major Jones, affichait
un tel mépris envers les Canadiens français que Jos n’eut d’autres
choix que de relever le défi que celui-ci lui lançait.
L’infortuné
major fût tout juste capable de regretter ses paroles car à chaque
coup, Jos lançait : " Insulterez-vous encore les Canadiens français
?
" Une
série de timbres canadiens de 1992 porte sur des héros populaires
qui sont passés à la légende et comprend entre autres Jos Montferrand,
ce célèbre héros folklorique, bagarreur et lutteur au cœur sensible
et joueur de savate inégalé. . .
Auteur
: Benjamin Sulte, Jos Montferrand

La légende
de la Corriveau
On la
disait d’une grande beauté, faisant commerce avec le diable et coupable
d’avoir tué 7 ou 8 maris.
Je vous
livre ici l’histoire, la plus exacte possible, de Marie-Josephte Corriveau,
la plus belle fille des environs de Saint-Vallier, petit village situé
à quelques kilomètres de Lévis.
Ce qui
s’est réellement passé Un jour de printemps 1749, les paroissiens
du petit village de Saint-Vallier se rendent joyeusement à l'église
pour célébrer le mariage de la plus belle jeune fille des environs.
Le futur
mari est l’heureux vainqueur dans une lutte où les plus beaux et les
plus riches jeunes hommes du comté lui ont disputé la belle.
Ce couple
vécut heureux pendant 11 ans.
La seule
ombre au tableau peut-être est que le couple restera sans enfant au
plus grand malheur du père de Marie-Josephte, habile charpentier du
village.
Malgré
sa grande beauté, elle a tout de même une réputation assez redoutable,
elle est surnommée la sorcière de Saint-Vallier.
On la
dit empoisonneuse de profession et faisant commerce avec le diable.
Elle
détient, paraît-il, des formules de poisons foudroyants ou à effets
lents dont elle aurait hérité de La Voisin, son ancêtre maternelle
(La Voisin, Catherine Monvoisin, célèbre aventurière française et
diseuse de bonne aventure qui fut condamnée à être décapitée et brûlée
par Louis XIV en 1680).
Un matin,
les voisins voient arriver la jeune femme tout échevelée et tout hébétée.
Elle
raconte en sanglotant qu'elle vient de trouver son mari mort dans
son lit.
Le défunt
est populaire et il est sincèrement regretté.
Chacun
manifeste ses plus vives sympathies à la jeune veuve.
Personne
ne soupçonne la veuve tant sa douleur est évidente.
Pourtant,
quand on la voit au bras de Louis Dodier et convoler en secondes noces
3 mois seulement après la mort de son premier mari, cela fait jaser.
Trois
ans s'écoulent et les soupçons finissent par s'effacer les uns après
les autres.
Le matin
du 27 janvier 1763, on trouve le corps de Louis Dodier, son deuxième
mari, dans son écurie, le crâne fracassé par ce qui paraît d'abord
être les fers de son cheval.
Cette
fois, la justice s'informe et l'enquête démontre que le malheureux
n’a pas été frappé par le cheval mais par une fourche de fer retrouvée
près de là.
On exhume
le corps du premier mari et l'on constate que sa mort a été causée
par du plomb fondu versé dans les oreilles, durant son sommeil sans
doute.
Les preuves
s'accumulent, tellement écrasantes contre la veuve, que personne n’a
plus aucun doute sur sa culpabilité.
Durant
le procès, un incident spectaculaire se produit tellement que l’avocat
de la Couronne s’étouffe et en perd sa perruque.
Le père
de Marie-Josephte, maintenant un vieillard à cheveux blancs, s’avance
vers les juges, s'agenouille et en sanglotant dit : Arrêtez, messieurs
! Ne condamnez pas une innoncente.
C'est
moi qui ai tué Louis Dodier.
Je suis
le seul coupable; faites de moi ce que vous voudrez.
Fou de
douleur suite au témoignage d'une certaine Isabelle Sylvain, et en
ne voyant aucun moyen de sauver sa fille qu'il adore, il vient se
sacrifier pour elle.
Marie-Josephte
accepte froidement et sans broncher le " sacrifice " de son père.
M. Corriveau est condamné à être pendu.
Quant
à Marie-Josephte, pour complicité, elle est condamnée à recevoir 60
coups de fouet en 3 lieux différents : sous l'échafaud, sur la place
du marché de Québec et dans la paroisse Saint-Vallier, à raison de
20 coups à chaque endroit.
Également,
à être marquée à la main gauche de la lettre "M" avec un fer rouge.
La cour
condamne également Isabelle Martin pour parjure lors de son témoignage
et à recevoir, elle aussi, 60 coups de fouet dans les mêmes conditions
que Marie-Josephte Corriveau, mais que la lettre à être marquée au
fer rouge sur sa main gauche serait le "P".
Son père
est mené à la prison à côté de sa fille qui, habitée par la joie d'avoir
échappé à l'échafaud, ne daigne même pas lui jeter un regard de pitié
et de reconnaissance.
Le supérieur
des jésuites à Québec, le révérend père Clapion, est appelé auprès
du condamné à mort pour recevoir sa confession.
Il est
estomaqué d'apprendre que la fille du condamné et bel et bien coupable.
Suite
à la confession du vieillard, le prêtre lui fait comprendre qu'il
n'a pas le droit de sacrifier sa vie et de fruster les fins de la
justice.
La vérité
est révélée aux autorités et l'on est d'autant plus implacable pour
la meurtrière qu'elle a lâchement consenti à voir son vieux père subir
la pendaison à sa place.
Un nouveau
procès a lieu et la sentence, cette fois est : Marie-Josephte Corriveau
sera mise à mort pour ce crime, par pendaison, sur les plaines d'Abraham.
Son corps
sera enchaîné et suspendu à l'endroit que le gouverneur croira devoir
désigner.
Après
l'exécution, on forge sur le cadavre de la suppliciée une enveloppe
"de fer" que l'on suspend une quarantaine de jours au bras d'un immense
gibet sur les hauteurs de Lévis.
Quelle
chose effrayante que cette cage de fer qui se balance au vent pour
les habitants de Lévis et les passants, toute cette histoire marque
l’imagination des gens et devient vite sujet de légendes plus ou moins
noires.
À une
époque où les déplacements sont difficiles, les gens, pour un certain
temps, n’osent plus passer par la pointe de Lévis et préfèrent se
rendre à Québec par voie d'eau pour faire leurs achats et vendre leurs
denrées.
Cela
causa un tort considérable aux petits commerces et aux aubergistes
de l'endroit.
Une nuit,
quelques citoyens, moins superstitieux que les autres, détachent la
cage de la potence et l’enfouissent le long du mur d'enceinte du cimetière
dans un petit espace réservé aux suppliciés et aux noyés inconnus.
Cela
reste secret et donne lieu là encore à de nouvelles rumeurs, le diable
est venu chercher sa complice …
Au fil
des ans, ce n’est plus 2 maris que La Corriveau a assassiné mais 7
ou 8 avec milles détails quant aux circonstances tragiques.
En 1849,
la cage est découverte et fait parler d'elle à nouveau.
Elle
est exhumée et offerte aux regards curieux des gens.
Cela
dure une couple de semaines mais un beau matin, on s’aperçoit que
la cage a disparue.
Elle
était pourtant tenue sous clé dans le sous-sol de la sacristie.
Le diable
l’a-t-il encore une fois enlevée ?
Non,
le diable, cette fois s’appelle P.T Barnum (les cirques Barnum & Bailey).
Maintenant,
ceux qui visitent le Boston Museum peuvent apercevoir une vitrine
où l’on aperçoit une masse de vieilles ferrailles brisées, tordues
et rongées par la rouille et le feu.
Une petite
pantcarte porte cette inscription "From Quebec".
C'est
tout ce qui reste de la fameuse cage de la Corriveau, sombre témoin
de la barbarie d'un autre âge.

La roche
pleureuse
Charles
se réjouissait du printemps hâtif cette année-là.
Il pourrait
ainsi être de retour plus tôt à l’Île-aux-Coudres, durant l’été indien,
pour épouser la belle Louise.
En 1806,
lors d’un printemps particulièrement hâtif, la grande débâcle avait
libéré le Saint-Laurent et permis la circulation des bateaux beaucoup
plus tôt que par les années passées.
Un jeune
navigateur, Charles Desgagnés, songeait, en fumant sa pipe au bord
du quai de l’Île-aux-Coudres, qu'il pourrait entreprendre plus tôt
que coutume son voyage annuel vers l'Europe ou, comme il le disait
lui-même, vers " les vieux pays ".
Chaque
printemps, en effet, il remplissait son navire de bois équarri pour
le livrer dans les chantiers maritimes d'Angleterre.
Il se
réjouissait de la débâcle qui hâtait son départ, car il pourrait ainsi
être de retour en octobre, vers le dernier temps doux, pour épouser
la belle Louise, sa fiancée.
À la
mi-mai, les cales de son trois-mâts étaient remplies et les provisions
hissées à bord.
Il alla
saluer sa vieille mère et partit vers la pointe de l’île, là où habitait
Louise.
Il ne
la trouva pas chez elle. Son père, un cultivateur bourru mais bon
comme de la mie de pain, indiqua avec le bout de sa pipe l’extrême
pointe de l'île.
Louise
aimait s’y réfugier lorsqu’elle était triste.
Charles
l'y découvrit bien.
Elle
était assise sur une roche auprès de laquelle s'élevait un orme gigantesque.
Ne t'en
fais pas, ma Louise, murmura tendrement le jeune homme, je serai de
retour pour l'automne et, avant que ne finisse l'été indien, nous
serons mariés.
Sur ces
paroles, une affreuse corneille croassa et s'envola d'une des branches
de l'orme où elle était perchée.
Quel
mauvais présage !
Une corneille
!
Cet oiseau
maudit, compagnon du diable et ami des sorcières ! Louise pâlit.
Charles
tâcha de ne pas laisser percer son malaise.
Mais
une corneille qui croasse n'augure rien de bon !
Le jeune
homme, pour conjurer le mauvais sort, prit la main de Louise et y
mit un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait fait pour elle.
Elle
détacha le ruban rouge qui liait ses cheveux, l'enroula autour du
bouquet qu'elle pendit à une branche du grand orme, au-dessus de la
roche où elle était assise.
Sous
ce bouquet, sous cet arbre, sur cette pierre, jura la belle Louise,
je viendrai sans faillir guetter ton retour !
Ils s'embrassèrent
alors sans entendre le claquement des ailes de la corneille, étouffé
par le bruit des vagues qui s'échouaient sur la grève.
Le lendemain,
au point du jour, Charles larguait les amarres pour l'Angleterre.
Sur la
pointe de sa roche, Louise suivit longuement des yeux le navire qui
était d'abord gros comme une montagne, puis devint grand comme une
colline, et qui, enfin, se confondit à l'horizon.
L'été
et ses trois saisons s'installèrent : celle des framboises, celle
des fraises et le temps des bleuets.
Louise
songeait à la décoration de la maison qu’elle irait habiter avec son
futur époux et que son père et ses frères construisaient durant l’absence
de Charles.
De la
plus haute fenêtre du pignon, on pouvait apercevoir la pointe de l'île,
la roche et l'orme où se balançait encore le bouquet, sec désormais.
C'est
dans cette pièce certainement qu'elle installerait le ber de leur
premier enfant !
À l'été
succéda l’automne.
Il sembla
à Louise que la forêt, avec ses couleurs chatoyantes, avait endossé
pour elle un habit de noces !
Au temps
des bleuets répondit celui du blé d’Inde et des épluchettes à n'en
plus finir, puis le moment des pommes.
Nous
étions à la fin septembre et le trousseau de Louise était terminé.
La maison
était prête et il ne manquait plus qu'y résonnât le rire de Louise
ou la voix de Charles.
Tout
l'été, Louise était allée s'asseoir sur sa roche, auprès de l'orme,
sous le bouquet, à la pointe de l'île.
Mais
à présent que la date du retour approchait, elle y passait de longues
heures, le regard scrutant le lointain.
Le soir,
à la brunante, elle rentrait à pas lents chez son père.
Et l'été
indien s'en fut !
Et octobre
et l'automne s'en allèrent !
Et les
volées d'outardes, après s'être attardées sur les battures, se regroupèrent
et, bruyamment, passèrent au-dessus de l’Île-aux-Coudres !
L'horizon
demeurait tristement solitaire : Charles ne revenait point...
Assise
sur sa roche, Louise pleurait sans entendre le croassement moqueur
de la corneille perchée à la cime de l'orme.
Au village,
les rumeurs voyageaient vite.
Les maldisants
suggéraient que Charles et son équipage étaient certainement allés
courir la galipette à Londres!
Qui donc
pouvait savoir vraiment ?
Seule
sur sa roche, Louise pleurait et l'espoir était sa réponse.
Quand
le temps se fut refroidi, que toute la végétation fut recouverte d'une
épaisse couche de neige et que toutes les eaux du Canada furent gelées,
Louise dut se contenter de scruter la mer par la fenêtre du pignon
de sa maison déserte.
Battu
par le nordet, on apercevait le ruban rouge du bouquet danser au bout
d'une branche.
Ce fut
un long hiver sans joie.
Lorsque
les glaces fondirent, Louise retourna, à la pointe de l'île, assiéger
sa roche et tourmenter l'horizon.
Elle
racontait tout bas ses malheurs et elle appelait son amoureux.
Toujours
elle pleurait.
Un beau
soir de mai, un messager vint annoncer que Charles avait péri en mer.
Louise,
poussa un cri et sortit de la maison en courant.
Depuis
lors, nul ne la revit plus. Son père se rendit à la pointe de l'île,
où elle avait coutume de s'attarder.
Anxieux,
il s'assit sur la roche.
De sa
voix forte il appelait sa fille : Louise, Louise, où es-tu ?
Louise,
réponds à ton père !
Le silence,
qui explique bien des choses, le silence expliquait au père de Louise
qu'il ne reverrait jamais plus sa fille.
Une fée
en effet, touchée par le chagrin de la pauvre fille, l'avait changée
en source, en roche pleureuse, pour qu'à travers les flots, elle puisse,
dans l'océan, retrouver et s'unir à son amant perdu en mer.
L'homme
regarda le filet d'eau claire, cette petite source qu'il n'avait jamais
remarquée auparavant, surgir de la roche et se déverser en mer.
Il s'y
abreuva.
Au-dessus
de la roche, pendu à un ruban rouge, un frais bouquet de fleurs sauvages,
bercé par la brise, lançait dans l'air mille parfums exotiques.
Sur une
branche de l'orme chantait maintenant un bel oiseau blanc.
Auteur
Charles Le Blanc, Contes et Légendes du Québec,
Nathan,
Paris, 1999, pp. 103 à 111

La légende
de la Dame Blanche
Certains
prétendent que son voile, emporté le soir de sa noyade, aurait donné
naissance à la mince cascade coulant à l’ouest de la chute Montmorency.
Par une
belle journée d’été de 1759, elle cours rejoindre son fiancé, brave
et vaillant jeune homme au regard de braise.
Après
les durs travaux de la journée, ils se rejoignent souvent en haut
du Grand Sault (chute Montmorency), là où l’on découvre l’Île d’Orléans.
À la
fin de l'été, une fois les récoltes terminées, ils s'uniront pour
toujours.
À l’abri
des regards, près de la chute, ils font mille et un projets d’avenir.
L’été
bat son plein lorsque résonnent les premiers coups de tambours.
Le jeune
couple doit se résigner à la séparation car on appelle le jeune soldat
au combat.
Les Anglais
veulent enlever cette nouvelle terre d’Amérique aux mains des Français.
Les femmes
et les enfants vont se mettre à l’abri au fond des bois, emmenant
bêtes et provisions.
Quant
aux hommes, jeunes et vieux, ils restent au bord du fleuve Saint-Laurent
pour défendre leur terre jusqu’au dernier souffle s’il le faut.
La flotte
anglaise sillonne le fleuve.
Partout,
on aperçoit les bateaux de Saunders, immobiles et canons pointés vers
la côte.
Toute
la colonie est sur le qui-vive.
La terrible
bataille éclate au matin du 31 juillet 1759 au pied des chutes Montmorency,
et qui emporte le courageux jeune homme.
Lorsqu’un
commandant apprend la triste nouvelle à la belle, elle sent son âme
se retourner.
On lui
apprend que son fiancé a combattu avec bravoure, mais c’est bien maigre
consolation pour un coeur qui aime.
Elle
repense au fier jeune homme qui l’a quittée brusquement à l’appel
des clairons.
Un soir
de pleine lune, continue la légende, folle de douleur, elle revêt
la robe blanche qu’elle avait préparée pour la noce, recouvre sa chevelure
d’un long voile et se lance du haut des rochers surplombant la chute,
là où tant de fois elle est venue avec son fiancé.
Le vent
s’empare de son voile, le fait virevolter et le transporte au loin.
On ne
revoit jamais plus la jeune femme, pas plus que son fiancé.
Encore
aujourd’hui, à la pleine lune, les gens de l’Île d’Orléans peuvent
apercevoir distinctement la belle de blanc vêtue, suspendue au-dessus
des eaux, chevelure au vent, et qui semble chercher son fiancé dans
les eaux de la chute.
Certains
prétendent aussi que son voile, emporté le soir de la noyade, aurait
donné naissance à la mince cascade coulant à l’ouest du torrent.
Auteur
: Cécile Gagnon: Contes traditionnels du Québec